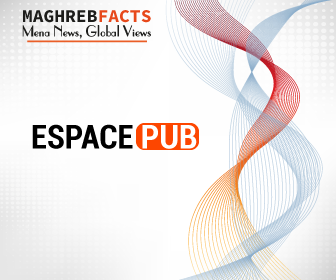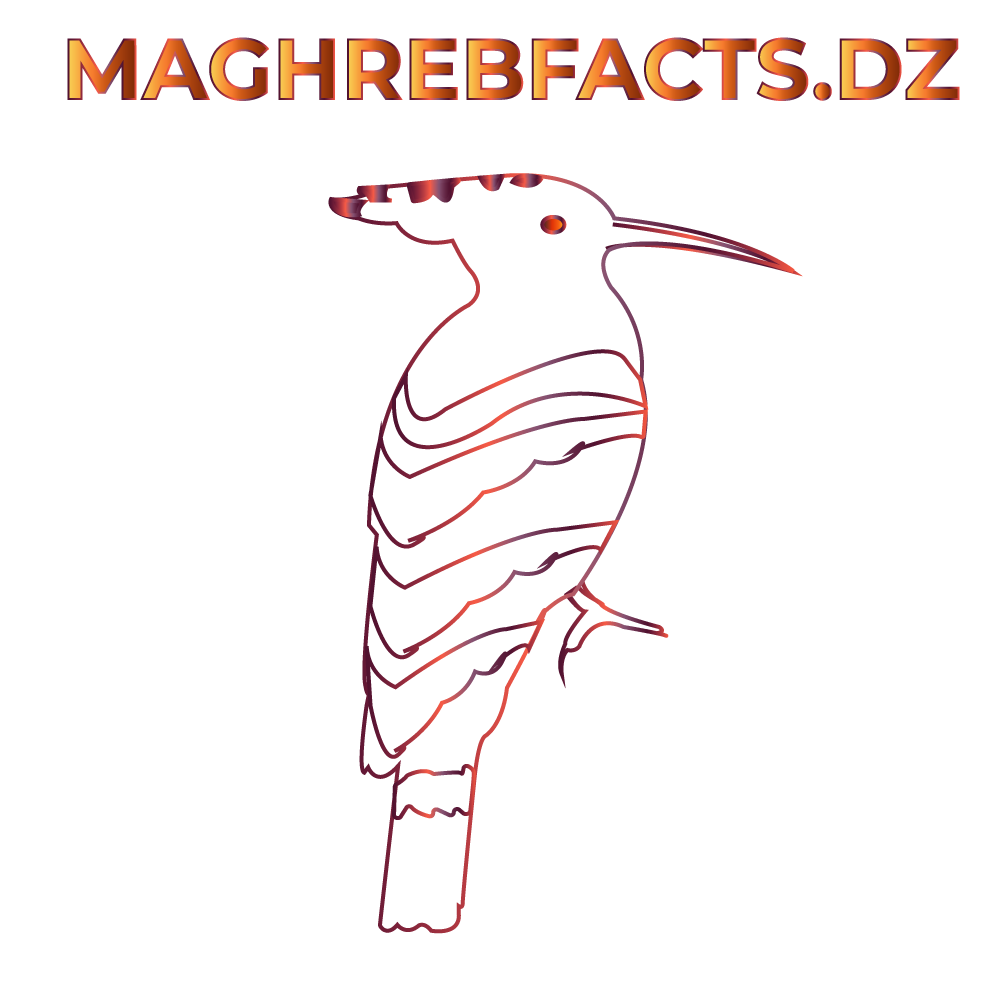Les approches sur l’économie algérienne ne manquent pas et elles sont toutes d’une générosité qui laisse rêver. Seul point d’achoppement, aucune ne prend en compte le sous-développement structurel, soit la caractéristique fondamentale du problème. Les déterminants de ce sous-développement étant de fait évacué.
Et pour cause. Ils remettraient à plat toute la problématique qui voudrait simplifier la situation, car ils sont le produit de la division internationale du travail dans laquelle l’Algérie a été inscrite dès le début du 19ème siècle. La même qui est en vigueur et qui fait drainer les richesses de la périphérie vers les centres impérialistes.
Réduite à l’état de colonie, par la France, l’Algérie a vu son économie profondément assujettie aux logiques de la métropole et aux intérêts du colonat. Son agriculture a été dévoyée au profit des cultures spéculatives et son industrie embryonnaire, industrie de substitution, se résumait à quelques fabriques sans prétention internationale, c’est-à-dire sans stratégie d’accumulation en dehors du marché local. Les infrastructures de base, par conséquent, lorsqu’elles existaient se limitaient à la desserte des centres de colonisation et ne portaient jamais la préoccupation d’un développement intégré du pays.
Sur le plan sociologique, les Algériens étaient exclus de toute possibilité de promotion intellectuelle, encore moins sociale. Soumis au code de l’indigénat, jusqu’au bout, ils ne seront que quelques milliers à avoir pu s’émanciper de l’illettrisme et quelques centaines à accéder aux études supérieures.
A l’indépendance, avec le départ des Européens, quelles que soient les conditions de son enfantement, le jeune Etat a hérité d’abord du terrible défi d’encadrement.
Au plan économique, la bourgeoisie nationale famélique, était très loin de pouvoir servir de moteur au développement, compris dans le sens de la réponse aux incommensurables besoins d’une population sortie de l’enfer colonial.
Ce furent les collectifs d’ouvriers qui prirent en charge le maintien en production des usines et des terres abandonnées.
La solution ne pouvait être que ce capitalisme d’Etat, sous la couverture idéologique de « socialisme spécifique « , qui pouvait amorcer la prise en main de l’économie et l’émergence du patronat actuel, issu de manière plus ou moins occulte des flancs du secteur d’Etat, grâce aux « industries industrialisantes ».
La rupture avec le capitalisme d’Etat, l’ouverture du marché extérieur et le démantèlement du secteur public, ont eu lieu depuis plus de vingt ans, sans qu’il y ait une initiative privée notable. A l’inverse, l’Etat continue d’être le seul recours contre le chômage et les déficits sociaux multiformes, tout en étant au centre de reproches qui lui imputent l’échec de la libéralisation, sous le prétexte fallacieux qu’il est responsable d’un « climat des affaires » qui bloque les investisseurs.
Cette attitude est relayée par des voix internes qui sont l’expression de ces couches sociales « émancipées » qui se sentent, aujourd’hui, suffisamment fortes pour revendiquer une place dans les centres de décision, une part de pouvoir, un accès à la prédation. Grâce à une capacité de nuisance qui repose, essentiellement, sur la formidable pression des puissances occidentales et sur leurs menaces à peine voilées.
Une foule d’experts apportent, ensuite, leurs analyses et leurs solutions, sans aucune allusion à l’échec de leurs théories en face de la crise qui fait s’effondrer des pays autrement plus outillés que l’Algérie. Pourquoi seraient-elles valables chez nous ?