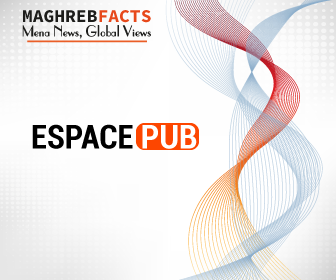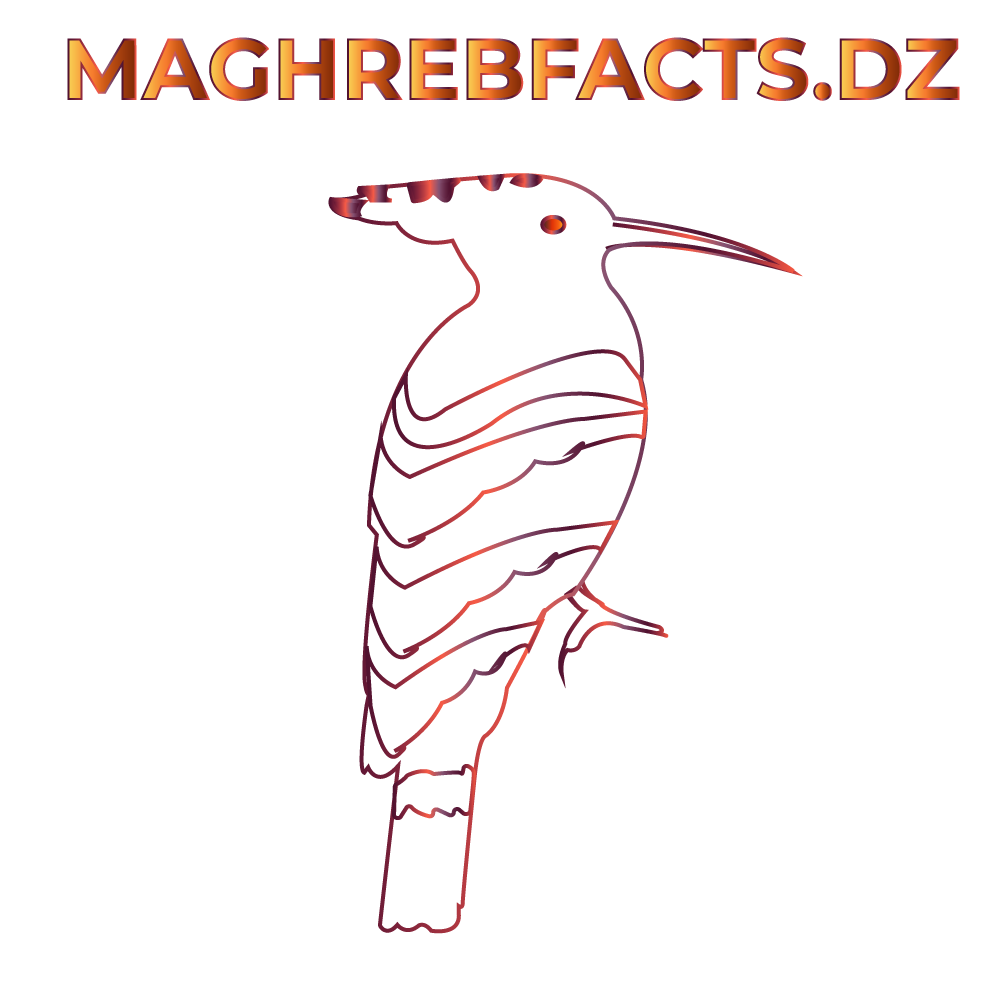Avec son quatrième roman, « Le Vent a dit nom » (Ed. Apic) le jeune prodige algérien de 25 ans, Mohamed Abdallah, revient sur les événements qui précédèrent la guerre d’indépendance de l’Algérie avec la création en 1954 du FLN et le début de la lutte armée contre la France coloniale. Il succède à Nassuf Djailaïni comme lauréat du prix Ahmed Baba décerné pendant la 15e édition de la Rentrée littéraire du Mali.
MF
Bamako| Annie Ferret
Le talentueux romancier Mohamed Abdellah a brillé parmi ces jeunes plumes prometteuses de la littérature algérienne. Sa distinction à l’unanimité, lors de cet événement continentale où son promoteur l’édition APIC, est présent depuis 2008, décrochant déjà, plus de 4 prix, n’était point une surprise. « Le vent a dit son nom » nous plonge dans un voyage aux rythmes hilarants et des personnages attachants, dans les profondeurs de la société algérienne, à la veille de la guerre de libération.
Automne 1954, à la Mauresque, demeure du quartier indigène de la ville d’Oran, Anir Ramdane, dont la sensibilité, le goût pour les livres et un don hors du commun pour la musique ont tout de suite sauté aux yeux de Simone, une Française amie de sa mère et professeur de français, fait son entrée au collège des Palmiers, fréquenté par les enfants français. Il y rencontre Shanez, la seule élève qui lui ressemble un peu, et des professeurs qui vont changer sa vie. D’un classicisme étonnant, écrit dans une langue maîtrisée et tendue, truffée d’alexandrins et de rimes internes qui sont peut-être la marque d’une écriture jeune, ce roman est autant d’apprentissage que d’engagement. À cet instant de bascule de l’enfance à l’âge adulte qui, selon les remous de la grande histoire et son impact sur les destinées individuelles, peut être un passage plus ou moins brutal, Anir n’aura pour sa part que peu de temps, comme les autres personnages du livre, pour la plupart ses aînés, tel Aomar :
« Oran était en fête ce jour-là : on célébrait la défaite d’une bête immonde sans craindre celles qui sévissaient encore. On avait réquisitionné les populations indigènes, sommées de se joindre aux réjouissances. Aomar et ses camarades remontaient le long de l’avenue du Loubet, entourant leur professeur, monsieur Djaffar. Ils agitaient leurs drapeaux tricolores, animés par une joie sincère de voir les noires années vichystes arriver à leur terme. Tandis qu’ils traversaient la place des victoires, s’approchant du Rouet, Aomar s’était mis à guetter les femmes en haïk. Sa mère lui avait promis d’être sur le passage du cortège, peut-être même de pousser un youyou lorsqu’elle l’apercevrait. […] Avant qu’il n’ait pu l’apercevoir, cependant, monsieur Djaffar avait réalisé un coup d’éclat. Glissant sa main sous sa chemise, il en avait sorti un drapeau blanc et vert qu’il brandissait fièrement. Aomar avait alors arrêté de chercher sa mère des yeux, captivé par le spectacle qui venait de prendre forme. Pour sûr, il avait déjà vu ce drapeau dans son enfance. (…) des acclamations montaient de part et d’autre de l’avenue. Un sourire victorieux fendit alors le visage de l’enseignant tandis que le soleil conférait à la scène une aura presque sacrée. Il avait paru à Aomar que ces instants de grâce avaient duré une éternité. Puis, soudain, sans prévenir, la mort avait frappé. Le jeune garçon avait d’abord entendu un craquement macabre, avant que le sang de monsieur Djaffar ne gicle, couvrant le drapeau d’un sigle rouge. Le professeur s’était alors effondré, des cris d’horreur avaient remplacé les exclamations de joie. »
La symbolique du drapeau algérien, dont le mythe se réécrit ici, prend tout son sens à mesure que l’année s’écoule, scellant le destin d’un jeune garçon et celui de sa génération, étrangement parallèle à celui de la génération précédente, que l’on suit au long de retours en arrière, mais aussi qui grouille et gronde dans les caves, y faisant fermenter quelque chose de sombre et de dur, l’explosion de la Toussaint rouge, quand des attaques et des attentats sont menés un peu partout dans le pays contre l’oppression française. En dépit du contexte agité et violent, Mohamed Abdallah parvient à faire vivre tous les petits instants du quotidien. L’histoire se raconte autant du point de vue des femmes et des enfants que de celui des hommes, les unes comme les autres entrant en résistance à leur manière. Aomar, en enseignant puis en écrivant des pamphlets, Norredine, en prenant la place de son ami auprès des enfants, chacun ayant à cœur de passer le témoin aux plus jeunes.
« – Il ne faut pas être trop dur avec les nôtres, fit Kamal d’une voix posée. Notre peuple a été abîmé par l’Histoire et n’a pas encore acquis une discipline. Ces choses-là s’apprennent au fur et à mesure que l’on s’engage, et nous ne devons surtout pas désespérer au moment où notre conscience politique s’éveille enfin-« .
– La politique… répéta Sehli, voilà une belle chose que la politique. Pas simple, pour sûr. Mais qui promet tant. Enfin, ce peut être difficile de tout suivre parfois. Certains disent qu’il suffirait de donner un bout de terre à chaque pauvre pour que la faim disparaisse. D’autres demandent à ce qu’on leur confie tous les pouvoirs pour redistribuer les richesses équitablement. D’autres encore crient à la folie et décrètent que toutes ces révolutions ne peuvent être que mortelles pour les hommes, qu’il vaut mieux améliorer les choses au jour le jour sans renverser la table. Comment savoir à qui nous devrions faire confiance ? »

Si le livre suit dans les détails les rues d’Oran au milieu des années 50, remontant de l’impasse des artisans jusqu’à Arzew et Mostaganem, faisant revivre les figures historiques des fondateurs du FLN, surtout celle de Larbi Ben M’hidi, qui organisa avec succès et unifia les actions dans tout l’oranais, il n’y a aucune lecture simpliste de l’histoire, mais une vision complexe et une réalité saisie sous tous ses aspects : les traîtres à la cause, les retournements, les alliés anticolonialistes parmi les Français. Pas de fausse nostalgie non plus : l’histoire est un monstre qui avance et les chants seuls sont éternels, tout comme la culture, qui n’a ni couleur ni nationalité, mais s’offre à tous en partage. Tout s’écrit sans didactisme aucun, mais au contraire, avec des pages sublimes de réflexion sur la création littéraire et la musique, en rapport avec les événements en marche, parce qu’aucune œuvre ne saurait s’affranchir du contexte dans lequel elle est produite
« Son écriture était le produit d’une conjoncture, de son monde et pas d’un autre. Parfois, il se sentait presque impuissant, comme emporté malgré lui par un flot impétueux. L’Histoire lui intimait les thèmes que ses romans se devaient de traiter, la réalité qu’ils se devaient de montrer. Une telle injonction, souvent répétée, courait le risque d’inhiber son expression, de lui soutirer l’ivresse créatrice qui s’était saisie de lui dès l’instant où il avait résolu de donner vie à ses livres. N’était-il pas, en effet, prisonnier de l’ordre dicté par les événements dont il était le témoin ? » (p.32)
On ne s’étonnerait pas que l’auteur, qui fait œuvre d’historien en même temps que d’écrivain, parle ici un peu de lui-même, et surtout on se réjouit sans surprise que le vent ait porté déjà si loin le nom de Mohamed Abdallah, récompensé coup sur coup par le prestigieux Grand Prix Assia Djebar du roman 2022 et par le prix Ahmed Baba 2023, remis lors de la rentrée littéraire du Mali à Bamako à la fin février.
Maghrebfacts / Afrique culture.com