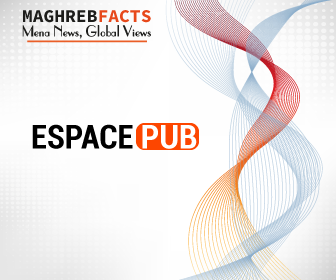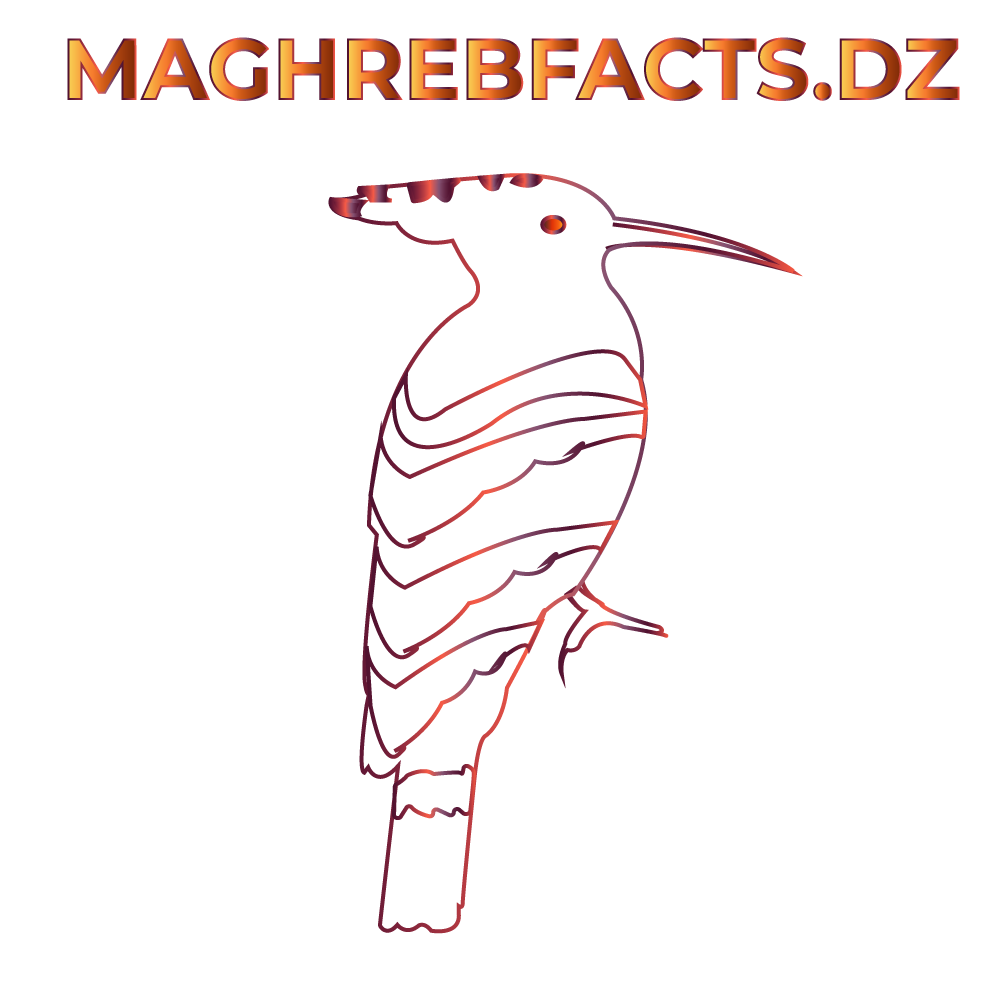Par: Ahmed Halfaoui
Analyse du début du « Hirak », avant l’irruption des prédateurs aux intentions hégemonistes.
La toute puissance des médias sur la compréhension du monde, une compréhension faite de raccourcis et de simplifications, a laissé très peu de place à des lectures objectives sur ce qui anime la planète. Il en a été ainsi pour l’Algérie, un pays dont le moindre événement est examiné à l’aune des lignes éditoriales et non selon ses déterminants réels.
C’est pour cela que, il y a quelques mois, l’irruption de dizaines de millions d’Algériens dans la rue a laissé aphones la majorité des soi-disant spécialistes et autres experts patentés ou, du moins, les a figés dans une expectative dont ils avaient et ont encore peine à se défaire. Le fait est que toutes leurs grilles d’analyse se sont avérées inadaptées. D’autant que le processus n’obéissait à aucun schéma connu par ailleurs et se distinguait nettement de la conceptualisation, somme toute confortable, usitée pour ce qu’on appelle le printemps arabe, parce que, à l’inverse, il est résolument patriotique et ouvertement hostile aux ingérences, fussent elles simplement médiatiques.
Le mouvement populaire affiche aussi une unité, inédite en apparence, de toutes les régions du nord à l’extrême sud et d’est en ouest. Du jamais vu depuis la lutte de libération nationale, fortement convoquée, revendiquée et clamée par l’emblème national brandi en tant que rappel à l’ordre des gouvernant. Ce slogan : « Le pays est le nôtre…Et nous y ferons ce qui nous plaira de faire… », fuse, dénotant d’une profonde signification mémorielle et émotionnelle.
Cinquante sept ans, auparavant, l’Algérie, à l’indépendance, a connu une situation quasi unique dans l’histoire des nations. Elle perdait presque tout son encadrement, en quelques mois. Il faut dire que, colonie de peuplement, elle a développé une formation sociale assez particulière, où le code de l’indigénat consacrait les rapports sociaux discriminatoires et protégeait les privilèges des colons et des pieds noirs en général, quelle que soit leur place dans la société.
Ce statut en faisait les maîtres à tous les échelons du fonctionnement administratif, économique et institutionnel, car il était extrêmement rare qu’un indigène accède à un poste de direction, encore moins de commandement. Ce ne fut donc pas sans conséquences que s’est produit l’exode des européens d’origine qui laisse une société décapitée, au sens propre du terme. Néanmoins, la reprise en main immédiate de l’appareil administratif, des unités de production et des terres, par les travailleurs a évité leur paralysie, mais les défis restaient incommensurables, pour le nouvel Etat dont les caisses étaient vides, alors que les attentes de la population étaient au plus haut niveau, après les blessures et les destructions subies au cours de sept années et demie de guerre.
Un Etat qui ne verra jamais émerger des partenaires économiques susceptibles de s’interposer entre lui et les demandes d’un peuple, au cours de sa courte histoire. Même s’il a pu, un temps, satisfaire et offrir des perspectives aux aspirations des Algériens, d’abord par l’instauration d’un capitalisme d’état, abusivement qualifié de socialisme, aux projets volontaristes.
Projets qui ont doté le pays d’infrastructures de base conséquentes, notamment, d’un tissu industriel indéniable, de structures et de personnels de santé, d’un système éducatif de masse (une université par wilaya versus 300 étudiants en 1962 et 30% de taux de scolarisation des enfants), d’un réseau électrique et de gaz naturel performant, d’un parc de logements appréciable et du premier réseau routier en Afrique.
Pendant qu’émergeait à l’ombre du secteur public économique et, surtout, de ses flancs un secteur privé dont les ambitions vont se manifester plus tard, lorsque les premiers craquements vont affecter l’appareil politico-économique dit socialiste et ébranler, après la mort de Houari Boumediene, l’hégémonie du parti-état le Front de libération nationale, qui avait déjà perdu son aura historique. C’était vers la fin des années 1970 et au cours des années 1980.
Survint alors l’effondrement de toutes les certitudes, avec celui des recettes pétrolières, et l’expérimentation de l’émeute en tant qu’expression du mécontentement social, jusqu’à l’abandon du capitalisme d’état et à l’ouverture politique et économique au cours des années 1988-1989. Les Algériens découvrent, dans la foulée, les divergences mortelles qui vont les faire s’entre-tuer dans les dix années qui suivent. Suivit une période de relative paix sociale, avec l’ouverture de l’ère Bouteflika.
Le premiers mandat de l’homme ne souffre d’aucune contestation majeure et est mené tambour battant, à l’extérieur, comme à l’intérieur du pays. Ce sont les succès à l’extérieur qui sont les plus spectaculaires, avec la fin de l’isolement de l’Algérie. La popularité de l’homme est au zénith. Même les islamistes extrémistes et les dits démocrates purs et durs se joignent à lui (ils ne se retireront que sous la pression des événements du printemps noir en Kabylie). Ce fut le signe des premiers couacs, mais sans incidences notables sur le cursus du président, ni sur sa popularité.
Cependant la rupture avec l’état patron, l’ouverture du marché extérieur et le démantèlement du secteur public, ont eu lieu sans qu’il y ait une initiative privée notable. A l’inverse, l’Etat a continué d’être le seul recours contre le chômage et les déficits sociaux multiformes. On peut même constater une aggravation de la situation économique, si l’on considère l’évolution de la société dont les aspirations ont changé de nature et qui devient plus exigeante en termes de qualité de vie.
Dans le même temps, l’Etat est au centre de reproches qui lui impute l’échec de la libéralisation, sous prétexte qu’il est responsable d’un climat des affaires qui ne serait pas au niveau des desiderata de l’investissement étranger, puisque la notion de libre-échange s’est imposée ou a été imposée comme unique alternative pour le développement économique et social, et implémentée partout dans le monde sous le label de plans d’ajustement structurels (PAS).
Sur le front social, malgré d’importantes mesures au profit des démunis, dont la distribution de dizaines de milliers de logements, l’émeute se banalise et s’installe, en tant que mode de confrontation, reléguant la classe politique à la marge des rapports entre le pouvoir et la société, de même que les diverses associations et syndicats.
L’émeute se fond alors dans un système où les voies de la satisfaction des besoins et la réussite ne sont pas normalisées, connues et accessibles à tous. La complexité de la situation saute aux yeux. De haut en bas de la pyramide sociale, la grande majorité des individus se confrontent à l’obligation de créer par eux-mêmes les conditions de résolution de leurs problèmes ou de réalisation de leurs aspirations. Jouer des coudes n’est pas une expression trop forte pour décrire les différents parcours qui animent de nombreux actes vitaux. L’installation d’un bidonville à l’encontre de l’urbanité, des lois sur la propriété et de la préservation du domaine public, a le même sens que les passe-droits qui règnent plus haut dans la hiérarchie sociale. L’occupation des trottoirs par des vendeurs ambulants ou le racket au stationnement ne sont rendus possibles que parce qu’ils sont une généralisation du mode initial de la distribution de la richesse. Se servir dans l’impunité et au mépris de tout. L’évident viol des règles proclamées et enseignées, qui chantaient l’égalité comme principe irrévocable, n’a pas fini de susciter les frustrations. La courte histoire de la décantation économique, n’a pas effacé la mémoire du mode, trop récent, d’accumulation, n’a pas annulé les filiations sociales encore vivaces, ni souvent le voisinage. Les agrégations spatiales restent partielles. Les principes déclencheurs de la lutte pour l’indépendance, encore présents, animent toujours les esprits. Ces principes faits d’aspiration à l’équité et à la fraternité sont encore au cœur de toutes les problématiques sociales, même si l’individualisme, en apparence, semble avoir pris le pas sur la solidarité traditionnelle. Pourtant, la mise en œuvre de la « démocratie » (et avec elle de passerelles politiques devant assurer le dialogue social et la libre expression) avait pour objectif de bannir la violence de l’espace public et de consacrer les revendications sociales dans des programmes éligibles. Ces programmes se sont réalisés en fait, le plus souvent, dans le sillage de l’émeute. Décidément les représentativités supposées ne jouent aucun rôle notable. Du moins c’est ce que nous enseignaient, régulièrement, les routes coupées, les édifices saccagés et les clameurs des révoltes sporadiques. Ceci étant, l’Algérie n’a décidément pas pu sécréter une classe politique au sens des ambitions dites démocratiques. Par défaut, ce sont certains journaux qui font office de partis et qui joue la double fonction de tribunes et d’organes d’information supposés.
Et puis, le 22 avril 2019, les Algériens se sont étonnés eux-mêmes, par millions, unis autour du refus de l’humiliation d’être encore représentés par un président grabataires, ils sont sortis à l’unisson sans casser une seule vitre. Ils n’étaient plus des émeutiers, mais un corps social très civil.
Reste à savoir si les causes profondes du soulèvement vont être identifiées, en tant que telles, avec la remise en cause de l’obéissance à l’autorité immanente de la finance internationale, en prenant en compte l’avertissement de Joseph Stiglitz, ex président du Conseil des consultants économiques du président Bill Clinton, qui disait « Les politiques et les économistes qui promettent que la libéralisation du commerce va améliorer le sort de tous sont des imposteurs. » Ou encore prendre au sérieux ce que disait le jeudi 25 septembre 2008 à Toulon, Nicolas Sarkozy à ses concitoyens soit : « Il faudra imposer aux banques de financer le développement économique plutôt que la spéculation. »
Ce qui dicte, rationnellement, de libérer la réflexion sur le sous-développement systémique, des pistes consacrées. Ce qui nécessite le recours à la planification des investissements, en fonction des moyens et des besoins les plus larges, de mieux penser l’aménagement du territoire et de bannir les options aléatoires et saupoudrées.
Préalablement, la preuve étant faite de l’incapacité de la classe politique, de toute la classe politique, d’imposer une solution démocratique à la question du pouvoir, et le seul recours, du bloc social dominant, à l’homme providentiel, au Bonapartisme, ayant démontré ses limites, seule une vaste concertation populaire peut asseoir une solution pour la sortie de crise.
Demeure la question lancinante de savoir si, malgré sa diversité idéologique et socioéconomique, le peuple réussira à tirer les leçons de son passé et à secréter des directions représentatives à même de débattre des enjeux essentiels et des réponses à donner en termes de gestion concertée des richesses nationales, dont celles du sous-sol représentent plus de 90% des entrées en devises. En un mot, mettre fin à la corruption et à la gabegie qui sont les principales cibles des manifestants.