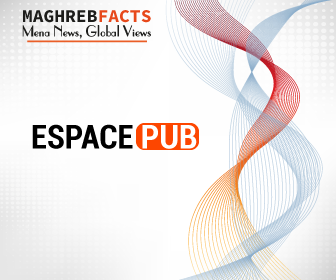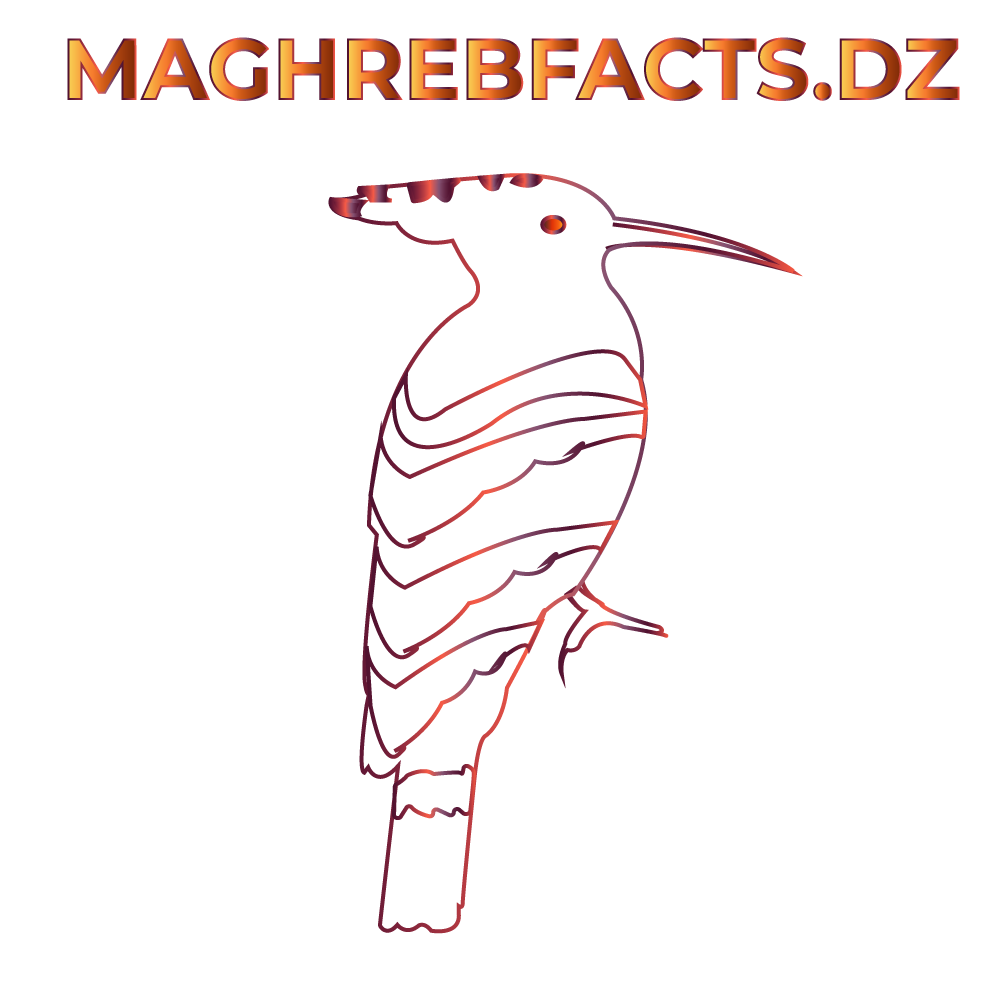Par Adlene Mohammedi source RT
Tandis que le second tour des présidentielles tunisiennes se prépare, Adlene Mohammedi, chercheur en géopolitique et spécialiste du monde arabe, propose de revenir sur les aspects politiques et institutionnels de ce scrutin.
Depuis le soulèvement de 2010-2011 et la chute du régime autoritaire de l’ancien président Zine el-Abidine Ben Ali – décédé le 19 septembre –, les Tunisiens ont exprimé une soif de politique. En quelques années, les Tunisiens se sont dotés d’une nouvelle constitution – à travers une assemblée constituante – avant d’élire démocratiquement un nouveau parlement et un président au suffrage universel direct. Cinq ans après l’élection de Béji Caïd Essebsi, les Tunisiens s’apprêtent à se choisir un nouveau président de la République.
Le climat politique en Tunisie et le résultat du premier tour poussent à nuancer cette soif de politique. Car si les Tunisiens n’ont aucune raison de regretter une époque où le pouvoir s’autonomisait d’eux et les malmenait, certains signaux indiquent une forme de défiance à l’égard de la pratique politique dans la Tunisie post-révolutionnaire.
L’expression d’une certaine nostalgie «benaliste» et antirévolutionnaire – qui s’explique surtout par la situation économique désastreuse dont pâtit le pays –, le taux de participation décevant au premier tour (moins de 50%) et la qualification de deux candidats présentés comme «antisystème» sont autant d’indicateurs du rapport ambigu qu’entretiennent les Tunisiens avec la vie politique de leur pays.
Un duel inattendu
Kaïs Saïed (18,4%) et Nabil Karoui (15,6%) sont les deux candidats «indépendants» qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle tunisienne. Ils sont talonnés par le candidat soutenu par le parti Ennahdha, Abdelfattah Mourou. Ce dernier, qui se définit avant tout comme conservateur, avait pris ses distances avec la formation islamiste avant d’accepter d’en être le candidat.
Les citoyens tunisiens ont finalement opté pour un autre conservateur favorable à la révolution de 2010-2011 : le juriste Kaïs Saïed. Il devance l’homme d’affaires libéral, placé en détention provisoire pour blanchiment d’argent et fraude fiscale en pleine campagne. Au-delà du caractère cocasse de cette configuration, ce duel oppose deux profils en apparence différents (le juriste semble plus rigide sur la question des mœurs) mais représentant un même rejet des élites au pouvoir.
Ces élites au pouvoir étaient représentées par trois candidats adossés aux principales formations au Parlement (Ennahdha, Tahya Tounes, Nidaa Tounes) : Abdelfattah Mourou (12,9%), le Premier ministre sortant Youssef Chahed (7,4%) et le ministre de la Défense sortant Abdelkrim Zbidi (10,7%)
Entre paradoxe institutionnel et impasse politique
Quel que soit le vainqueur de ce scrutin, et en dépit de la grande légitimité inhérente à une élection au suffrage universel direct, rappelons que les prérogatives du président sont limitées. Selon l’article 77 de la constitution tunisienne, «[il] lui appartient de déterminer les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la protection de l’Etat et du territoire national des menaces intérieures et extérieures, et ce, après consultation du Chef du Gouvernement».
En effet, si le président de la République peut procéder à certaines nominations et soumettre «exceptionnellement» (article 82) au référendum certains projets de loi adoptés par le Parlement (ceux relatifs à l’approbation des traités internationaux et aux libertés et aux droits individuels), les grandes orientations politiques du pays sont entre les mains du gouvernement et de son chef. Celui-ci est issu de la majorité au Parlement.
Autrement dit, et sans vouloir minimiser le rôle du chef de l’Etat, l’avenir économique et social du pays se décide au gouvernement, responsable devant le Parlement. S’il devait y avoir des «conflits de compétence» entre le Président (élu directement par le peuple) et le chef du gouvernement (issu de la majorité parlementaire), ce serait à la Cour constitutionnelle de statuer (article 101). Celle-ci n’est malheureusement pas encore en place. Si le président n’est pas en phase avec la majorité parlementaire, ce qui est possible malgré le soutien apporté à Kaïs Saïed par certains partis politiques (dont Ennahdha au second tour), de tels conflits ne sont pas à exclure.
Outre ces risques institutionnels, il faut bien comprendre que ce résultat aux élections présidentielles (l’arrivée en tête de deux personnalités extérieures aux partis au pouvoir – même si Nabil Karoui a soutenu Nidaa Tounes contre Ennahdha en 2014 –) est le résultat d’une pratique politique contestable : les grandes coalitions gouvernementales soutenues par des grandes coalitions parlementaires. Derrière le joli mot de «consensus», en réalité, les grandes formations politiques se préservent et se partagent le gouvernement. C’est ce qu’ont fait Nidaa Tounes (parti hétérogène créé pour contrer Ennahdha), Ennahdha et, plus récemment, Tahya Tounes (formation récente du chef du gouvernent sortant). Voter pour des «indépendants» à une présidentielle devient le seul moyen de sanctionner tout ce monde à la fois.
La Tunisiens – qui souffrent des réformes encouragées par le Fonds monétaire international et qui craignent un accord de libre-échange complet et approfondi avec l’Union européenne qui porte le risque d’une mise sous tutelle économique – ont besoin de dissensus et non de consensus. Dans une démocratie, on doit être capable d’identifier une majorité au pouvoir – à sanctionner si besoin – et une opposition. Les gouvernements «technocratiques» et d’ «unité nationale» sont un moyen efficace de gouverner (notamment avec le soutien des institutions étrangères) mais favorisent la colère extraparlementaire. Cette menace pèsera assurément sur le gouvernement issu des élections législatives du mois prochain